Le Québec, le statut d'organisme de bienfaisance et les prières militaires
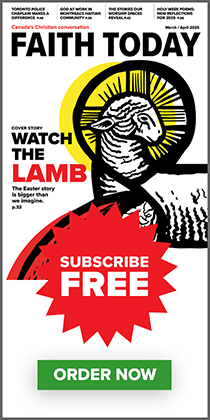
La contribution positive des communautés religieuses au Canada est remise en question par une nouvelle série d'initiatives visant les institutions religieuses et l'expression publique de la religion.
Bon nombre de ces défis sont regroupés dans un rapport inquiétant sur l'avancement de la sécularisation présenté au gouvernement du Québec en août. Ce rapport de 300 pages offre une vision globale de ce que pourrait entraîner la sécularisation imposée par le gouvernement.
Les 50 recommandations comprennent notamment la facilitation du rejet des demandes d'accommodements religieux, la restriction de la location de salles dans des établissements publics (écoles, bibliothèques) et de l'utilisation d'espaces publics par les organisations religieuses.
Elles mettraient fin à la pratique consistant à informer les parents lorsque leurs enfants reçoivent un enseignement lié à la sexualité. Les universités pourraient refuser de fournir des espaces pour des activités religieuses. Une Journée nationale de la laïcité serait instaurée. Les avantages fiscaux et les subventions accordés aux organisations religieuses seraient supprimés.
Le rapport redonne vie à une idée récemment controversée visant à supprimer la « promotion de la religion », l'un des quatre motifs historiques justifiant l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance. L'Association humaniste de Colombie-Britannique avait formulé cette demande au comité fédéral des finances l'année dernière (ainsi que la suppression du statut d'organisme de bienfaisance pour les organisations « anti-avortement »).
Si la « promotion de la religion » était abandonnée, de nombreuses organisations religieuses pourraient toujours obtenir le statut d'organisme de bienfaisance, mais uniquement en se tournant vers l'un des trois autres objectifs caritatifs que sont la promotion de l'éducation, la lutte contre la pauvreté ou d'autres objectifs bénéfiques pour la communauté
The climate being created calls for silence about religious beliefs.
La commission fédérale des finances a inclus ces deux recommandations dans un rapport de 2024 adressé au ministère des Finances.
Qu'est-ce qui sous-tend ce programme de sécularisation ? Il s'agit en partie d'un changement dans la façon de concevoir la relation entre l'État et la religion. (Historiquement, les tribunaux canadiens ont interprété la religion de manière très large, incluant l'athéisme et l'agnosticisme).
Au Canada, il n'existe aucun obstacle juridique à la collaboration entre l'État et les organisations religieuses pour la fourniture de services d'intérêt public, le financement d'écoles religieuses ou l'autorisation de l'expression religieuse dans les espaces publics. Ces relations ont généralement été accommodantes et positives. La société bénéficie grandement des contributions des organisations religieuses, en particulier dans les domaines de la santé et des services sociaux.
Les programmes de sécularisation favorisent le passage d'une société laïque à une société séculariste. Laïque signifie ouvert à tous et ne privilégiant aucun, c'est-à-dire respectueux de toutes les positions sans pour autant en empêcher l'expression publique.
Séculariste, en revanche, signifie prôner la non-pertinence de la religion dans la vie publique et une ouverture à d'autres sources de convictions qui doivent être célébrées exclusivement.
Un exemple est la politique qui interdit aux aumôniers militaires de prier lors de cérémonies publiques. Cette politique limite les aumôniers à donner des réflexions laïques.
Le climat qui se crée impose le silence aux croyances religieuses. Pour reprendre les mots de Jésus dans Matthieu 5:15, un panier est placé sur la liberté religieuse.
Une telle exclusion est souvent justifiée au nom de la neutralité de l'État, un concept qui trouve son origine dans le devoir de l'État de protéger la liberté des groupes religieux contre toute ingérence de l'État, sans leur accorder ni faveur ni entrave.
Aujourd'hui, la neutralité de l'État est utilisée pour justifier le refus des gouvernements de collaborer avec les institutions religieuses en ne finançant plus les programmes confessionnels qui servent le bien public et en restreignant l'expression religieuse dans les espaces réglementés par le gouvernement afin de ne pas être perçus comme soutenant la religion.
Les avantages que la religion et les organisations religieuses apportent à la société canadienne sont bien documentés. Une relation saine avec l'État continuerait à favoriser une collaboration constructive avec toutes les communautés qui recherchent le bien public et chérissent la liberté.
Lorsque les personnes religieuses défendent nos libertés, s'expriment de manière civile sur des questions d'intérêt public et apportent une contribution constructive dans la sphère publique pour exprimer leurs convictions, elles constituent le remède le plus efficace contre la prétendue non-pertinence de notre foi. C'est ainsi que nous pouvons veiller à la liberté religieuse au Canada.
Bruce J. Clemenger est ambassadeur principal et président émérite de l'Alliance évangélique du Canada, et auteur de The New Orthodoxy: Canada’s Emerging Civil Religion (Castle Quay, 2022). Illustration : Bernardo Ramonfaur